Planet Arrakis
Jeux de rôle, jeux de plateau, prenez ce qui vous plait…Archive pour cinéma
Dune, beau et con à la fois…
« Yom asal, yom basal »
Un jour du miel, un jour des oignons
Le cinéphile dunien erre dans le désert depuis 1965, à la recherche d’une bonne adaptation de Dune. Un jour, il mange du miel, le lendemain, des oignons. La suite tant attendue arrive sur les écrans : Dune : Deuxième Partie, la bien nommée. Le Professorino crie au chef d’œuvre. Son père, le Naib Ludovico, n’est pas content et parle d’idiot cinématographique. C’est en réalité une cause perdue. Le Professore est un de ces fondamentalistes, comme dit Villeneuve, qui traquent l’hérésie dans chaque plan – tu ne prononceras pas le nom de Muad’Dib en vain !
La fatwa fera l’objet d’une prochaine chronique. Essayons donc de regarder ça uniquement sous l’angle cinématographique : là aussi, le compte n’y est pas. Rendons grâce néanmoins à Denis Villeneuve d’avoir quelques réussites. Le film a un point de vue, ce qui est rare dans les adaptations de bestsellers. Le cinéaste de Premier Contact déploie ici un débat dialectique entre la vraie foi (incarnée par Stilgar) et un athéisme post-moderne, où la religion n’est qu’un outil de domination des masses (un outil utile pour Jessica, ou scandaleux pour Chani). Villeneuve lance le débat à peu près correctement, mais dans la dernière ligne droite, son propos ne devient plus très clair (Paul, d’abord contre, devient pour).
Autre avantage, Villeneuve injecte un peu d’humour dans Dune, ce qui n’est pas vraiment le point fort du roman. Et puis visuellement, Dune est toujours aussi fantastique. Villeneuve filme le désert comme personne : ergs, couchers de soleil, récoltes d’Epice, ou combat d’arène en noir et blanc.
Beau, oui, mais con à la fois…
« Lourde est la pierre, et dense est le sable.
Mais ni l’un ni l’autre ne sont rien à côté de la colère d’un idiot. »
Qu’est-ce qu’un idiot de cinéma ? C’est quelqu’un (acteur, réalisateur, décorateur) qui ne réfléchit pas à son métier. Ses idées sont un flux de conscience, qui impriment directement la pellicule. À ce titre, Villeneuve est un idiot de cinéma. Prenons tout de suite les précautions d’usage : par bien des égards, Denis Villeneuve est notre frère. Il a notre âge, il vénère le même panthéon cinématographique (2001, Apocalypse Now!, Persona, Blade Runner), et c’est un fan sincère de Dune. Depuis l’adolescence, Villeneuve rêve de « faire » Dune. Il a même storyboardé le livre de Frank Herbert à l’âge de 13 ans. Et voilà, à 54 ans, qu’on lui donne la chance de le faire. On peut comprendre que l’aboutissement de ce rêve soit un achèvement.
Mais un cinéaste ne peut pas être qu’un fanboy. Filmer sa vision n’est pas du cinéma. Qu’est-ce que ce film veut dire ? Qu’est-ce que le spectateur va comprendre ? Ça, Denis Villeneuve n’y réfléchit pas. Est-ce que cela a de l’importance, si les images sont belles, si les acteurs sont bons, si les décors sont grandioses* ? Pour un film à gros budget, il n’est pas très compliqué de réunir les meilleurs talents. Les faire travailler ensemble à une grande œuvre est une tout autre affaire.
Un exemple : la maison de l’Empereur Shaddam IV. Une jolie scène bucolique, un petit pavillon en béton dans un coin de verdure… Mais l’Empereur est la personne la plus puissante, la plus riche de l’univers. Les Harkonnens et les Atreides sont ses vassaux. Pour le lecteur de Dune, pas de problème : il décode, il interprète. Mais pour le spectateur lambda, Christopher Walken est un être faible qui vit dans une petite maison : contresens !
Ensuite, l’Empereur arrive sur Arrakis dans un vaisseau magnifique, une immense boule métallique**. Il s’installe sur la planète et déploie un immense palais, argenté lui aussi. Contradiction : pourquoi le gars qui vivait dans une petite maison possède un si grand palais ?
La confrontation a lieu. Grâce à sa ruse et ses vers géants, Paul écrase ses ennemis. Voilà l’Empereur réduit à se retrancher dans le palais. Ses fidèles Sardaukar forment le dernier carré, faisant rempart de leur corps. Mais Paul pénètre dans le palais comme dans un moulin. Passe devant les Sardaukar. Se dirige vers le Baron Harkonnen. Et le tue, sans que personne ne s’interpose… Cette salle du trône, elle est dans l’obscurité, comme TOUTES les pièces de TOUT le film. Pourquoi l’homme le plus puissant de l’Univers habite dans l’ombre ? Pourquoi la déco (portes rondes, pièces obscures) est la même partout ? Pourquoi ses gardes ne combattent-ils pas ? Pourquoi cet homme, qui possède tout, habite dans un pavillon mal jardiné de Villeneuve-la-Garenne ? Tout cela pollue – consciemment ou inconsciemment – l’esprit du spectateur…
Soit on résout ces questions, comme le pense Kubrick, qui dit qu’on peut filmer n’importe quelle idée, à condition d’arriver à l’incarner correctement*** . Soit on évite au spectateur de se poser ces questions, comme le préfère Hitchcock****. Or ces contradictions montrent qu’il ne s’agit pas d’une volonté de Villeneuve, mais bien d’un oubli, d’un manque de réflexion. Il n’y a pas réfléchi, comme il n’y réfléchissait pas, déjà, dans Sicario.
Denis Villeneuve est un idiot de cinéma.
*C’est ce que semble penser le public, qui fait un triomphe à cette Part Two. On peut aussi penser que Dune touche un public habitué à bien pire (Marvel) et qu’il trouve enfin dans le film de Villeneuve quelque chose d’intelligent et mature.
** Comme Mitterrand, Villeneuve aime les formes simples : triangle/rond/carré.
*** « Hélas, les idées ne font pas les bons films. Il faut des idées dans les bons films, mais cela demande beaucoup de créativité artistique pour incarner fortement une idée… »
**** « Je retrouve ces erreurs partout : [le spectateur] découvre soudain qu’on a changé de lieu, sans explication, ou deux personnages portent le même costume, et de fait, on ne sait plus qui est le méchant… »
Chronique publiée également sur Cinefast
Dune sur Radio Rôliste

« Tenter de comprendre Dune sans connaitre ses projets de films inachevés, les sequel du fiston mal écrites, les règles de jeu incompréhensibles, c’est tenter de voir la Vérité sans connaître le Mensonge. C’est tenter de voir la Lumière sans connaître les Ténèbres. Cela ne peut être. »
A l’occasion de la sortie très attendue du Dune 2 de Denis Villeneuve, Lam Son de Radio Rôliste m’a gentiment invité en compagnie de deux experts d’Arrakis (Dorothée qui mène une campagne Modiphius et le grand Khelren lui-même, auteur, entre autres, de Dominion) à parler Epice, Gom Jabbar, et plis de l’espace. On discute des spécificités de l’incroyable univers d’Herbert, du livre et de ses suites, des films, et surtout bien évidemment des jeux de rôles qui se sont attaqué à la tête. Bonne écoute !
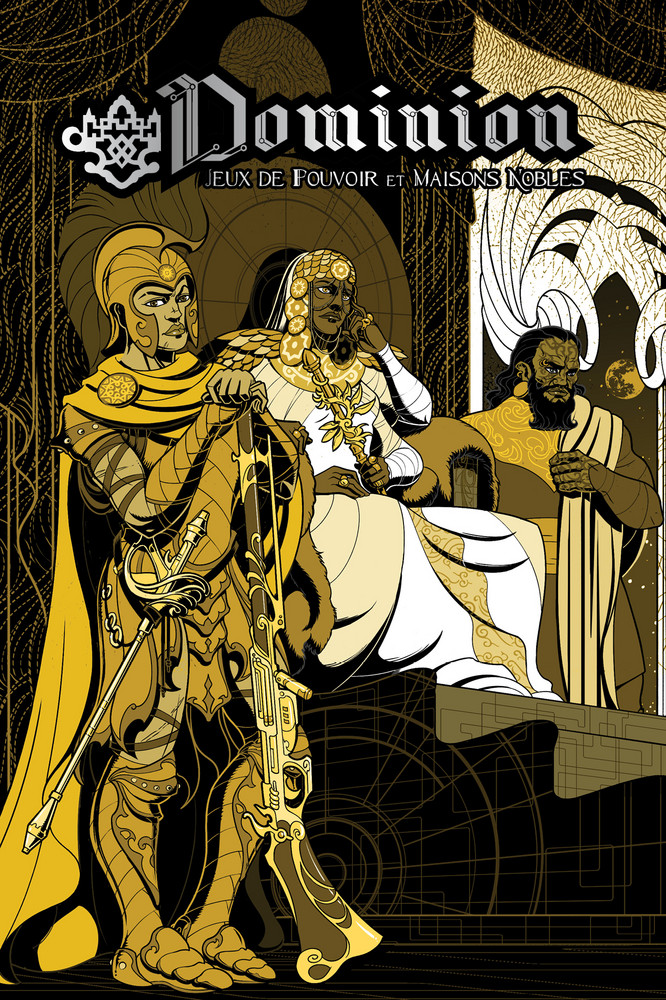
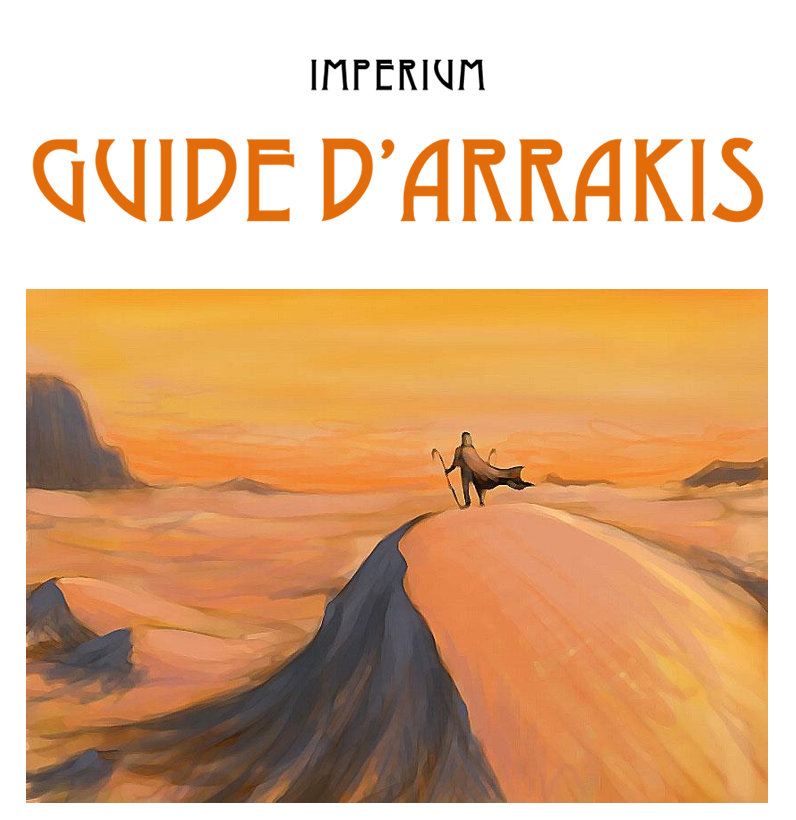

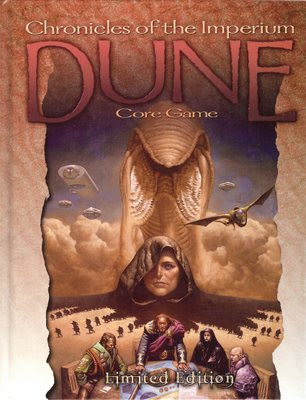
Donjons & Dragons : Le déshonneur d’Hasbro
Né du croisement improbable de la littérature de Fantasy* et du wargame napoléonien avec figurines, ce loisir était – quand nous l’avons découvert au début des années 80 – dans sa plus tendre enfance.
On créait un personnage sur une feuille de papier, en lui attribuant des caractéristiques chiffrées (sa force, son intelligence…), et on partait explorer des « donjons », sa plus simple expression ludique. Explorant virtuellement un ensemble de couloirs souterrains, nous y tuions à coup de dés le plus de monstres possibles… 40 ans plus tard, le Jeu de Rôles a bien évolué. Comme toute forme d’art, il a mûri. Des dizaines d’univers, des centaines de scénarios, bien plus subtils qu’une simple exploration de souterrains, ont été produits et joués. Et aujourd’hui, on incarne un personnage, on lui donne un passé, des dilemmes moraux : c’est un véritable personnage de fiction…
Tout ce que ne fait pas – somme toute – Donjons & Dragons, le film. Au-delà d’être un patchwork kitsch particulièrement laid, L’Honneur des Voleurs est une histoire ultra classique, sans personnages ni émotions. Des voyous à la ramasse, pitchés en une phrase (le père de famille négligent, la barbare en rupture de ban…) se retrouvent à lutter contre un mal antique qui veut détruire l’humanité… aka le scénario Copytop des studios hollywoodiens (Marvel & Co.) depuis des années…
Sur le plan visuel, pas mieux. En cela, le film respecte le matériau original : D&D a toujours été graphiquement atroce. Cinq éditions et quarante ans plus tard, il est toujours aussi laid : guerriers cheveux en brosse de quarterbacks texans, sorcières MILF peroxydées, châteaux dessinés par Disney… Normal pour un pays qui n’a jamais vu de châteaux forts… Le film fait de même en mélangeant allègrement des Marie-Antoinette, des Martin Luther et des épées antiques à la Conan le Barbare : tout ça est, pour les américains, est médiéval !
Mais le pire reste à venir : l’omniprésence du fan service, même pour le fan qu’est le Professore. Que le film cite visuellement des monstres (Mimic, Displacer Beast, Cube Gélatineux…), ou des objets magiques iconiques (Bag Of Holding , Horn Of Beckoning Death, Helm Of Disjunction…) fait plaisir. Mais le fan service sature littéralement les dialogues. Un name dropping totalement insupportable : Mordenkainen, Neverwinter, Baldur’s gate, etc., on cite même des règles du jeu…
Tout cela donne l’impression d’un gâchis (qui n’est pas immense, parce qu’on n’en attendait pas grand-chose), mais un gâchis tout de même. C’est mieux que le premier film de 2000, bien sûr, mais ça reste très loin de Game of Thrones, ou même de licences plus kitsch comme The Witcher ou Conan.
Et c’est dommage, car il y avait de la matière. D’une part, la partie comique est assez réussie, avec 2 ou 3 scènes cultes, et toute une série de blagues tongue-in-cheek pour initiés… Mais doublement dommage car Donjons & Dragons, le jeu, aurait pu s’appuyer sur les scénarios qui servaient de support à nos parties. Ces « modules » proposaient de belles aventures, mille fois plus originales que la lutte éternelle contre le grand méchant**… Hasbro n’avait qu’à se baisser pour les ramasser…
*Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien, le Cycle des Epées de Fritz Leiber, Elric de Michael Moorcock, Conan le Barbare de R.E. Howard, Terremer, de Ursula Le Guin…
** The Sinister Secret of Saltmarsh, où un repaire de pirates mène à complot d’homme-lézards
Castle Amber, où l’on explore la maison hantée d’une antique famille
The Secret of Bone Hill/The Assassin’s Knot, où l’on explore une ile pleine de mystères et où l’on résout un meurtre étrange
The isle of Dread, où l’on explore une ile peuplée d’antiques créatures
Expedition To The Barrier Peaks, un donjon qui se révèle être… un vaisseau spatial
etc.
Chronique publiée également sur CineFast
Le Trône de Fer, la grande métaphore finale
Je me permets de recopier la chronique que j’ai faite sur Cinefast car je pense qu’il y a beaucoup de fans du Trône de Fer qui traine sur Planet Arrakis… Je pense aussi que certains enseignements scénaristique de ce dernier épisode de notre série fétiche peuvent intéresser aussi les Rôlistes. Bonne lecture !
Les grandes séries ne meurent jamais. Le Trône de Fer, après avoir subi toutes les avanies possibles, le manque d’inspiration, la langueur, puis la stupide accélération, menant de fait à la destruction de la physique de son monde (distances abolies, et super héros chevauchant des dragons à grande vitesse chargés de de kérosène), le plus grand show du XXI° siècle se termine de façon éclatante.
Au bout d’une huitième saison totalement surprenante, aux rebondissements souvent maladroits ou irréalistes, Game of Thrones rattrape tout, dans un ultime épisode métaphorique et époustouflant.
Comme dirait Jonathan Franzen, des erreurs furent commises ; Comme dirait Tyrion, elles ont été réparées. En 75 minutes, la série boucle non seulement les histoires de son immense cast (sans avoir l’air de se presser), donne un cours de philosophie politique, propose une morale revigorante contredisant son propos principal, et se permet de commenter, en mode méta, la propre fascination qu’elle a engendrée. Revue de détail…
Tuer le tyran qui est en nous (3 leçons de philosophie politique)
S’il est une série politique, c’est bien celle-là. 73 épisodes sur la conquête du pouvoir, le Trône de Fer est à la série télé ce que Le Prince de Machiavel est à la politique (1).
Il appartenait aux auteurs de conclure sur la question initiale de la conquête du fameux trône, sachant qu’aucune solution ne pouvait être réellement satisfaisante. Si Daenerys gagnait, elle offrait une victoire moralement appropriée (le triomphe du tiers-monde opprimé) mais qui pouvait apparaître comme Hollywoodienne. Si au contraire Cersei sirotait tranquillement son cabernet dans le Donjon Rouge (probablement la fin la plus Game of Thrones, au passage), elle décourageait le fan qui souhaitait sa mort depuis le début. Quant à Jon Snow, le beau gosse, il n’avait pas l’air équipé pour le rôle de Grand Leader, et sa cote sombrait d’épisode en épisode…
Pourtant, c’est vers lui que se tourne le destin. Par la voix de Machiavel-Tyrion, évidemment. Daenerys a gagné, a exterminé toute la ville, et ses alliés sont plus inquiets que jamais. Jon rend visite à Tyrion, la Main démissionnaire. « La guerre n’est pas finie », lui dit-il en substance. Maintenant que Daenerys-la-Libératrice est prête à détruire la roue de l’oppression, et qu’elle a, comme tant d’autres, le sentiment d’être du bon côté, c’est une forme de jihad qui s’annonce, une dictature du Bien qui fera des millions de morts.
Première leçon : nous aussi, nous avons admiré cette jolie princesse libératrice d’esclaves. Elle l’a pourtant fait dans une furie meurtrière sans précédent ; sous prétexte que c’était des méchants nobles ou marchands, nous l’avons approuvée sans discernement (2).
Tyrion exhorte alors le faible Jon à choisir sa destinée, lui qui a toujours cherché à faire le bon choix, à protéger les gens. Lui seul peut désormais tuer le tyran qui s’annonce.
Et c’est bien Jon, qu’on présente comme un impuissant depuis cinq épisodes, qui va effectivement prendre ses responsabilités, car « l’amour est plus fort que la Raison », mais « le Devoir est la mort de l’Amour » (3).
Après avoir donné une ultime chance à Daenerys, l’abjurant de gouverner avec clémence, celle-ci refuse, avec la folie des dictateurs. Emilia Clarke apporte ici tout son talent et sa beauté juvénile, ce qui rend ses propos encore plus atroces. Hitler, en version jeune et blonde : « Je sais ce qui est bon ». Et ceux qui pensent autre chose ? « Ils n’ont pas le choix ! » (4) Sa mort est alors inévitable, dans une scène sublime d’ambiguïté.
Jon a rempli sa mission, il a tué le tyran qui est en nous, celui que nous appelons de nos vœux. Et il délivre au passage la deuxième leçon politique de Game of Thrones : ne choisissons pas nos leaders sur leur bonne tête, leur beauté physique, leur charisme, leur humour. Malgré l’amour que nous leur portons, réfléchissons… Elisons nos leaders avec notre tête.
Et c’est exactement ce que vont faire Benioff et Weiss à la quarantième minute.
L’épisode bascule à ce moment-là dans une scène assez artificielle : Tyrion, qui pense être condamné à mort, est présenté devant le conseil des grandes familles de Westeros. Il va alors servir d’arbitre au débat politique. Tyrion n’a pas le droit de parler, mais pourtant il va le faire avec éloquence. On lui demande, comme à Machiavel, comment gouverner ce tas de ruines que sont devenues les 7 Couronnes. Les chefs des plus puissantes maisons de Westeros, assises, s’opposent à Ver Gris, debout. Le chef des Immaculés, qui vient de perdre sa charismatique patronne, ne demande que justice, refuse tout compromis : un autre cycle de guerres se profile à l’horizon.
Ser Davos pose la première pierre : « Nous nous entretuons depuis longtemps ». Il propose une terre aux Immaculés ; il y a eu trop de morts, il faut trouver une autre issue. Suit alors un débat surréaliste pour trouver un roi. C’est la Grande Scène.
Première solution, prendre le plus âgé (Tully), vite remis à sa place par le vrai pouvoir (Sansa). La République, portée par Samwell Tarly ? Tout le monde rit de bon cœur (et le spectateur avec… On y reviendra…) Pourquoi ne pas faire voter les chevaux, pendant qu’on y est ! Sinon, il reste la compétence (Tyrion) ? Ça ne suffit pas non plus. Qui alors ?
Tandis qu’une musique élégiaque s’amorce, Tyrion Lannister suggère alors autre chose : le compromis, c’est à dire la base de la politique. Prenons le plus petit commun dénominateur : l’invalide, l’enfant, le faible, mais aussi le visionnaire : Bran. Et le fait acclamer par les Maisons de Westeros. Samwell avait donc raison ; on ne peut plus gouverner par simple héritage, sinon c’est une nouvelle guerre de succession. Si la démocratie est un choix un peu radical, commençons par une monarchie élective, hors des liens du sang. Car comme le dit Machiavel-Tyrion, « les fils de rois peuvent être très stupides. [Bran, qui ne peut engendrer] ne nous tourmentera donc pas. Désormais, les gouvernants ne naîtront pas, ils seront choisis (5) ». Et Tyrion d’asséner la troisième leçon de philosophie politique, tout autant destinée à Ver Gris qu’au spectateur : « C’est cette roue-là que Daenerys voulait détruire… »
Une fois de plus, les auteurs s’adressent au spectateur. Pourquoi avons-nous ri à la suggestion de Samwell Tarly ? Après tout, nous vivons dans des démocraties. Mais nous sommes fascinés par ces histoires de rois et de reines, et de princes héritiers du trône : il suffit de voir la passion qui s’empare des médias à la naissance d’un rejeton de la famille royale d’Angleterre (6). Pour autant, ce n’est pas le mode de gouvernement que nous avons choisi. Nous nous sommes débarrassés, souvent violemment, de la royauté. Cette Grande Scène s’apparente en fait à une forme de retour sur terre imposée au public par les auteurs. Vous êtes fascinés par tout ça depuis que vous regardez Games of Thrones, Star Wars, ou n’importe quelle heroic fantasy), mais réfléchissez ; ces gens-là ne sont que des dictateurs, et vous n’en voudriez pour rien au monde.
La morale de l’histoire (une autre vie est possible)
Juger la fin du Trône de Fer sur le plan du réalisme est un contresens. La fin d’une série ne peut se comprendre que comme une grande métaphore finale. Le but n’est plus de fournir des réponses réalistes, mais bien de faire passer un message. Qu’avons-nous appris pendant huit ans ? La fin est donc logiquement la partie la plus intéressante de ce Season Finale, quand l’épisode s’attarde sur le sort des chouchous des fans : la famille Stark.
Godard disait que le cinéma est une affaire de morale, et il n’a jamais autant eu raison. Si Game of Thrones est réussi, c’est parce qu’il apporte une morale satisfaisante à son histoire. Et même si l’on ricane à chaque fois que l’on évoque ce sujet, c’est qu’on le confond souvent avec LA Morale. Mais le plaisir basique que l’on retire d’une œuvre de fiction, c’est bien celui-là. Si la morale est satisfaisante (même s’agissant d’anti-héros comme Tony Soprano ou Tony Montana), le film est réussi. Si la morale est dérangeante (Suicide Squad, Deadpool), pas claire (HHhH) ou simplement fumeuse (The Dark Knight Rises), on est choqués ou on reste sur sa faim.
Ici, le final moral est incarné par la famille Stark : chacun sa route, chacun son destin. Il y a d’autres façons de vivre que la vengeance, la guerre, ou la soif éternelle du pouvoir. On n’est pas forcés de plier le genou, même devant son propre frère, on peut affirmer son indépendance, comme Sansa, nouvelle reine d’Ecosse de Winterfell. On peut se désintéresser du pouvoir et partir à l’aventure, choisir l’exploration, le grand ouest, parce que le pouvoir n’est pas fait pour nous (Arya). Et on peut rester attaché à ses racines (le Nord) et, en pionnier, étendre l’humanité dans des contrées réputées inhospitalières, au-delà du Mur.
Ces trois possibilités sont magnifiques, car elles sont totalement incarnées par leurs personnages, et leurs acteurs. Arya n’a jamais couru qu’après l’aventure ; même si c’est une tueuse, elle ne cherche pas le pouvoir. Sansa a toujours voulu être une princesse, de manière ridiculement adolescente saison 1, et sérieusement maintenant, comme un gouvernant crédible.
Quant à Jon Snow, le personnage menaçait de devenir de plus en plus falot. Mais cela s’apparente maintenant à une ruse scénaristique signée Benioff/Weiss pour frapper encore plus fort dans ce final éclatant.
Jon Snow, victime des compromis Ver Gris/Bran, est condamné à retourner à la Garde de Nuit. Le voilà revenu au point de départ, mais en fait, c’est un nouveau départ. Car il part bientôt à la tête de sauvageons souriants, pour conquérir pacifiquement des territoires au-delà du Mur. Et s’enfonce, magnifiquement, dans la forêt des origines, tandis qu’une première fleur repousse : Winter is gone.
Le voilà porteur d’une morale encore plus importante: nous ne sommes pas destinés à quelque chose, nous sommes ce que nous choisissons de devenir. Jon Snow est un targaryen, donc héritier du trône, donc fou ? (7) Pas du tout : Jon Snow est avant tout le fils d’un père adoptif qui l’a bien éduqué : Ned Stark, le seul véritable héros de la série. Élevé par un père aimant et dans les bonnes valeurs, son éducation prime sur le sang. Ce n’est pas parce que je suis héritier du trône que je dois en hériter, ce n’est pas parce que ma famille est folle que je dois l’être, ce n’est pas parce que je suis targaryen que je ne suis pas un vrai nordique. Tout simplement parce que j’ai été éduqué ainsi, et que je choisis de le rester…
Ce n’est pas pour rien que le Trône de Fer plait à l’extérieur du petit cercle de fans de l’Heroic fantasy. Car il détruit le mythe du surhomme, de la destinée, pour y superposer la politique et la vie.
Brisons le quatrième mur (et la fascination que nous avons engendrée)
« I had nothing to do but think these past two weeks. About our bloody history. About mistakes we’ve made. What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories. There’s nothing more powerful in the world than a good story.»
Les séries qui se terminent le font tous : un grand flash-back qui réunit tous les personnages (8), dont nous sommes follement tombés amoureux (ou alors, que faisons-nous devant notre écran huit ans plus tard ?(9)).
Ces personnages, nous voulons les revoir une dernière fois. Il y a plusieurs façons de faire sa sortie, en la ratant façon Lost (finir comme on a dit qu’on ne finirait pas), ou façon Twin Peaks saison 3 (par une immense destruction de tout ce qui a précédé). On peut aussi finir brillamment (Le Twin Peaks première manière avec une fin en forme de boucle, ou Friday Night lights, dont le final moral et choral ressemble beaucoup à celui de GoT).
On peut aussi ramener tout le cast (Six Feet Under, The Wire), et les mettre en prison pour l’ensemble de leurs œuvres (Seinfeld). Les séries les plus malines s’en tirent souvent par une pirouette (Mad Men, Les Sopranos).
Mais toutes les grandes séries passent par le scandale, et la déception. Et il est normal qu’une grande fascination engendre une toute aussi grande frustration. Car chacun, en réalité, veut sa fin. Les désirs des spectateurs sont par définition multiples ; ils entrent en conflit avec la fin, forcément unique, choisie par le scénariste.
Dans Game of Thrones, le Professore Ludovico en pinçait pour Cersei. Et l’ombre de Machiavel esquissait une belle fin pour la plus belle des MILF de Westeros : pendant que les idiots se battaient contre le Prince de la Nuit, la flamboyante rousse ramassait les morceaux, à l’instar des américains laissant les russes défaire les nazis. Mais le Professore n’est pas scénariste de Game of Thrones, pas plus que ceux qui souhaitaient que Jon et Daenerys se marient et aient plein de petits targaryens régnant en paix sur le monde.
C’est ce message qui est adressé au spectateur, dans la Grande Scène des Arènes. Un aparté théâtral de Tyrion destiné en apparence aux familles de Westeros mais en réalité au public : « J’ai bien réfléchi dernièrement » Vous aussi, le public ? Vous en avez élaboré des fins pour GoT, non ? « Mais qu’est-ce qui unit vraiment les gens ? Les histoires ; il n’y a rien de plus puissant qu’une bonne histoire… »
Tu dois comprendre, ami spectateur, que tu n’es qu’un spectateur ; on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut pas te donner la fin que tu souhaites. Réveille-toi ! Tu ne nous as pas suivis jusque-là pour entendre ce genre de fadaises ??? Il faut que nous, les auteurs, nous finissions cette histoire, pour vous unir une dernière fois.
Alors oui, nous avons « commis des erreurs, connu des mariages, des guerres, des naissances », nous avons eu « nos triomphes, et nos défaites » mais tu dois accepter cette fin : Bran sera le dépositaire de cette histoire, car tu n’as pas d’autre choix, petit spectateur. (10) Tu peux faire tes pétitions en ligne, rugir sur les réseaux sociaux, mais l’artiste, c’est nous, et personne d’autre. Même pas George Martin, dont tu aurais tout autant critiqué la fin de Game of Thrones qui lui reste à écrire…
Tais-toi. Arrête de tout vouloir contrôler. Regarde. Ressens. Et pleure…
(1) Ce n’est pas pour rien qu’à l’épisode précédent (S08e05), Twingodex, jeune philosophe de 17 ans, nous faisait remarquer que Daenerys et son dragon-B.52 ne faisaient qu’appliquer le programme du Prince, chapitre 2 « Comment on doit gouverner les Cités ou Etats qui avant d’être occupés vivaient sous leur propres lois ? » Réponse machiavélienne : « En vérité il n’y a pas d’autre façon sûre de les posséder que de les détruire. Et qui devient seigneur d’une cité habituée à vivre libre, et ne la détruit pas, doit s’attendre à être détruit par elle » (2) « When she murdered the slavers of Astapor, I’m sure no-one but the slavers complained; after all, they were evil men. When she crucified hundreds of Meereenese nobles, who could argue they were evil men? The Dothraki khals she burned alive, they would have done worse to her. Everywhere she goes, evil men die and we cheer her for it. » (3) Tyrion : “Love is more powerful than reason” Jon Snow: « Love is the death of duty. And sometimes, duty is the death of love »(4) Daenerys Targaryen: Because I know what is good. And so do you. Jon Snow: I don’t! Daenerys Targaryen: You do! You do, you’ve always known! Jon Snow: What about everyone else? All the other people who think they know what’s good? Daenerys Targaryen: They don’t get to choose. Be with me. Build the new world with me! This is our reason! It has been from the beginning, since you were a little boy with a bastard’s name and I was a little girl who couldn’t count to twenty! We do it together! We break the wheel…together. (5) « Sons of kings can be stupid as you well know. [Bran] will never torment us. That is the wheel your queen wanted to break. From now on, rulers will not be born, they will be chosen. On this spot, by the lords and ladies of Westeros, to serve the realm. » (6) Comme le faisait remarquer quelqu’un, il n’y a pas de raison de se passionner pour Archie, le jeune fils de Meghan et Harry ; il n’a aucune chance d’atteindre la couronne d’Angleterre. Ou alors, ce serait bien pire que Game of Thrones. Ça voudrait dire qu’il aurait tué son père, sa mère, son oncle, sa tante et son cousin, sans parler de ses grands-parents… (7) « You think our House words are stamped on our bodies when we’re born and that’s who we are?! Then I’d be fire and blood too! She’s not her father, no more than you’re Tywin Lannister! » (8) D’autres scènes sont là pour faire ce passage (Tyrion raconte toutes les horreurs auxquelles il a participé, Brienne écrit une notice flatteuse de Jaime, Samwell termine A Song of Ice and Fire, le nouveau Conseil réunit les anciens personnages, etc.) (9) « Why do you think I came all this way? » (10) « [Bran] is our memory, the keeper of all our stories: wars. weddings. births. massacres. famines. Our triumphs. Our defeats. Our past. »
Godless
Le big sky. Ce n’est pas seulement le titre original de La Captive aux Yeux Clairsd’Howard Hawks, c’est la meilleure définition que l’on pourrait donner de la Terre des Fantasmes, quelques secondes après y avoir posé pour la première fois le pied. Quand on arrive aux États-Unis d’Amérique, c’est ce qui vous frappe en premier : le ciel. Un immense et bleu, devant, derrière, sur les côtés, sans limite. Un ciel de paradis, blanc comme les nuages qui y paressent… Un pays de géants, incroyablement beau.
Godless : BigSky + Féminisme
C’est aussi ce qui frappe de prime abord dans Godless : la magnifique représentation – renouvelée – de cette immensité. Pourtant, elle n’a pas manqué de glorieux représentants dans le western classique, de la Monument Valley de John Ford, aux étendues neigeuses immaculées de Jeremiah Johnson. Mais c’est comme si Scott Frank avait su trouver pour Godless de nouveaux pinceaux, une nouvelle palette, pour filmer l’ouest, ses grandes plaines, ses déserts et ses forêts.
Pour une fois nous allons faire chronique commune avec Planet Arrakis, le blog de jeu de rôle du Professore. Car par un effet de synchronicité typiquement Jungien, ce qui se passe dans la vie se passe dans la série, et inversement. Le Professore Ludovico anime depuis quelques mois une partie de jeux de rôle western baptisé La Nuit des Chasseurs*. L’un de ses joueurs, l’auguste Beresford, nous signale Godless, « une série qui va vous plaire », tant elle ressemble aux aventures qui nous occupent autour de la table de jeu. On regarde donc. Et on est fasciné par les ressemblances : la vieille mine, la ville du Wild West, son saloon et ses putes, les indiens qui rôdent, les soldats perdus de la Guerre de Sécession… Normal, dira-t-on : dans les deux cas, on fait appel aux clichés du western, mais cela va bien au-delà. Dans le jeu, Karl Ferenc (il y a beaucoup de Cinefasters, à commencer par Le Snake, autour de la table), tire dans le genou d’un journaliste pour lui apprendre la vie. Dans le film, la peintre tire dans le genou pour apprendre la vie à un Agent Pinkerton. Il y a un cercueil, bourré de dollars, qui traîne quelque part dans La Nuit des Chasseurs. Idem dans Godless. Et une ambiance fantastico-biblique pèse sur le fatum des deux fictions.
Les clichés, malgré leur mauvaise réputation, font le genre, au cinéma, en jeu de rôle, en littérature. Ils sont les piliers sur lesquels le public s’appuie pour s’aventurer en terrain connu, et connivent, avec l’auteur. Pas de film de zombie sans blonde hurlante, pas de film de guerre sans soldat héroïque, pas d’heroic fantasy sans princesse à sauver… Sans, vraiment ? Pourtant, pas de blonde hurlante dans Walking Dead, pas de soldat héroïque dans La Ligne Rouge, et pas de princesse à sauver (c’est plutôt le contraire !) dans Game of thrones…
Car pour faire œuvre, il faut transcender les limites du genre, les respecter, les violer, bref, jouer avec. C’est exactement ce que fait Scott Frank dans Godless : plutôt que d’aligner ces clichés, il les transcende**, démontrant qu’avec du travail et du talent, on peut passer du produit commun de série B au pur chef d’œuvre. Car ce n’est pas un western normal, même si sa forme et son propos restent étonnamment classiques.
Godless : Esthétique du cliché
Godless est d’abord extraordinairement esthétique (ne ratez pas les vingt premières minutes, jamais on a filmé comme cela les grandes plaines sous l’orage). Mais ses histoires sont toutes simples, pour ne pas dire éternelles. Un outlaw sur la voie de la rédemption, un shérif veuf, inconsolable, et à la ramasse, une fermière mère courage, et un vieux gangster revenu de tout, godless, qui veut récupérer un magot et se venger.
Mais dans cette soupe de légumes classique, Scott Frank, scénariste averti d’Hollywood pour pointures 90’s (Branagh, Spielberg, Sonnenfeld, Soderbergh***) ajoute des épices tout à fait étonnantes. La ville est spéciale, peuplée quasi uniquement de femmes depuis l’effondrement de la mine qui a tué leurs maris. De cet événement quasi biblique, Scott Frank tire parti pour lancer l’idée d’une utopie féministe anachronique, à l’aube du XX° siècle. Et fait de ces femmes des personnages qui ont les clefs en mains : au-delà de la tragédie, voilà une incroyable opportunité de devenir maîtresse de son propre destin. On verra ainsi s’esquisser un personnage lesbien absolument pas ridicule (ce qu’il craignait fort d’être), des femmes fortes et de faibles femmes, des hommes forts qui se révèle faibles et vice versa…
De Titanic, on disait ici que c’était un film con, car les films cons osent tout, et c’est à ça qu’on les reconnaît. On pourrait dire la même chose de Godless, une série conne qui ose tout et réussit tout. Un film féminin et féministe, un western d’action et contemplatif, une histoire de rédemption et l’impossibilité de la rédemption, des histoires d’amour (qui finissent mal en général…) Tout en maintenant une tension érotique pendant six épisodes sans jamais succomber à la tentation d’en montrer plus…
Et ce n’est rien dire des grands acteurs qui transforment ces clichés en personnages de chair de et de sang, où même les pires ordures auront leur moment de gloire. Car Godless est peuplé de ces acteurs « B » dont personne (sauf les cinefasters) connaissent le nom : Jack O’Connell (Skins, ’71, HHhH), Michelle Dockery (Downtown Abbey), Scoot McNairy (Halt&Catch Fire, Monsters, Twelve years a Slave, Fargo), Merritt Wever (The Walking Dead), Thomas Brodie-Sangster (Le Labyrinthe, Game of Thrones), Sam Waterston (La Déchirure, The Newsroom), Jeff Daniels (Speed, The Newsroom, The Looming Tower) …
Si une série est capable de vous donner envie de dresser des étalons, que vous dire de plus ?
* La Nuit des Chasseurs, par Yno, disponible ici…
** La Nuit des Chasseurs, aussi, même si cette transcendance reste entièrement aux mains des joueurs et du Maitre de Jeu
*** qui coproduit Godless





